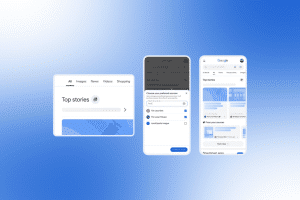Depuis près de 20 ans, Google Trends permet d’explorer les tendances de recherche sur le web. Aujourd’hui, Google franchit un nouveau cap : l’API Google Trends, attendue par de nombreux professionnels, ouvre ses portes à une poignée de développeurs en version alpha. L’idée ? Offrir une programmation avancée des données de recherche, pour des analyses plus poussées, automatisées, et personnalisées.
Ce qu'il faut retenir :
- L’API Google Trends facilite l’accès programmatique, évolutif et fiable aux données de recherche : contrairement au site web qui reste limité et manuel, l’API ouvre la voie à des usages intensifs, comparatifs et automatisés pour les entreprises, chercheurs et journalistes.
- Des données cohérentes, enrichies et disponibles sur 5 ans : l’API propose des données « normalisées » (au sens de Google) et donc comparables d’une requête à l’autre, couvrant jusqu’à 1800 jours (5 ans), avec un détail quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.
- Une segmentation géographique fine : l’API permet d’extraire les données par région ou sous-région, selon la norme ISO 3166-2, pour affiner l’analyse.
- Accès réservé, pour l’instant : seuls quelques développeurs peuvent tester la solution en version alpha, mais l’accès sera élargi progressivement dans les mois à venir.
Détail des fonctionnalités et usages
Les atouts de l’API
Google Trends, c’est cet outil qui mesure l’intérêt du public pour un mot-clé, une tendance ou un événement, grâce aux milliards de requêtes réalisées chaque jour sur Google. Jusqu’à présent, il fallait passer par l’interface web, ce qui limitait l’exploitation automatisée et la comparaison fine sur de larges jeux de données.
Avec l’API, Google promet une meilleure cohérence dans l’analyse : sur le site web, les résultats sont toujours recalculés de 0 à 100 sur chaque période, ce qui rend difficile la comparaison directe de deux requêtes côte à côte. L’API, elle, garantit une normalisation homogène sur toutes les requêtes, permettant ainsi de croiser, fusionner ou filtrer les résultats avec précision, y compris sur des centaines de termes à la fois (contre 5 sur le site web).
Cette cohérence aide les développeurs à suivre, par exemple, la montée et la descente d’intérêt pour un sujet spécifique, sans se soucier d’échelles variables, et de générer des tableaux de bord personnalisés.
Les données proposées
- Historique : jusqu’à 1800 jours (environ 5 ans) de données, ce qui couvre la plupart des analyses d’impact d’événements majeurs (élections, coupes du monde, réformes, etc.).
- Granularité : possibilité d’extraire les tendances au jour près, à la semaine, au mois ou à l’année, pour s’adapter à chaque besoin d’analyse.
- Géographie : filtrage précis par pays, région ou sous-région, pour des analyses locales ou comparatives.
- Sécurité et légèreté : possibilité de ne récupérer que la période qui vous intéresse, sans avoir à télécharger tout l’historique à chaque fois (contrairement au site).
Pour qui, pour quoi ?
- Recherche scientifique et publique : suivre l’évolution des centres d’intérêt de la population pour orienter les politiques publiques, la recherche médicale ou les initiatives citoyennes.
- Presse et édition : détecter les sujets émergents, enrichir le storytelling avec des données fraîches sur l’actualité, ou même générer du contenu éditorial personnalisé en fonction des attentes locales.
- Entreprises et marketing : identifier les tendances à la hausse, optimiser le référencement naturel, ajuster les stratégies de contenu ou anticiper les besoins clients en temps réel.
Où en est-on ?
L’API n’est pas encore ouverte à tous : Google propose une version alpha réservée à un petit groupe de développeurs, sélectionnés via un formulaire en ligne. L’accès sera progressivement élargi dans les prochains mois, mais pour l’instant, il s’agit de tester, de donner du feedback et de garantir la qualité du produit avant une sortie officielle.
En attendant, le site web Google Trends reste accessible à tous pour des recherches ponctuelles et des analyses rapides. Mais pour les usages professionnels intensifs, l’API promet un saut qualitatif majeur.